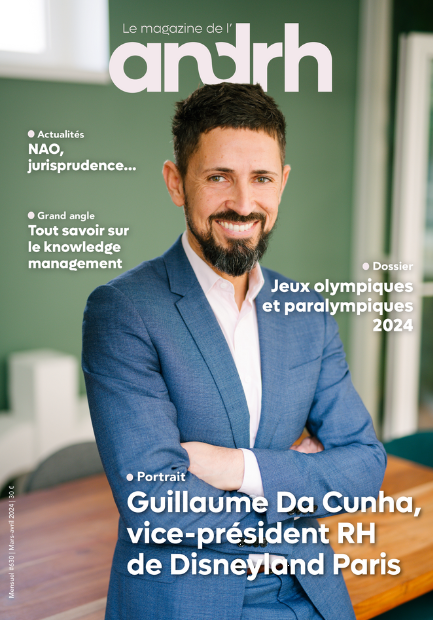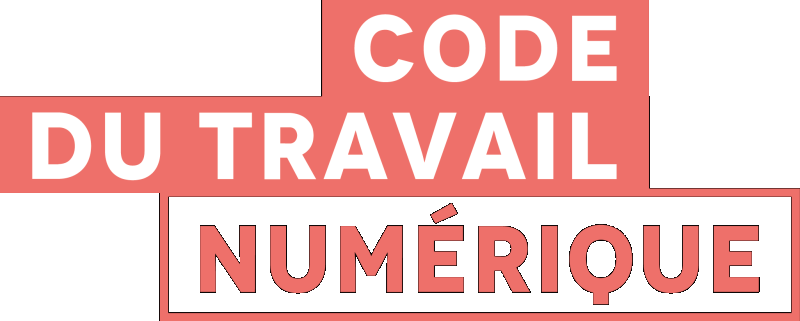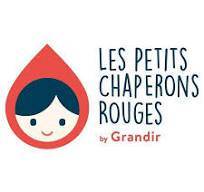Droit du travail ● Actualité sociale
 (D)RH : La récente jurisprudence sociale à ne pas manquer
(D)RH : La récente jurisprudence sociale à ne pas manquer
15 Avril 2024
Prospective ● Les Grands rendez-vous de l'ANDRH
 Université 2024 : Retrouvez les informations pratiques
Université 2024 : Retrouvez les informations pratiques
03 Avril 2024